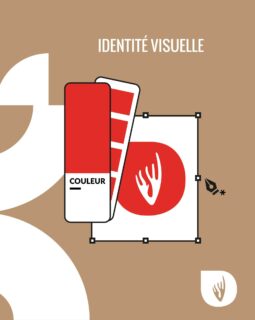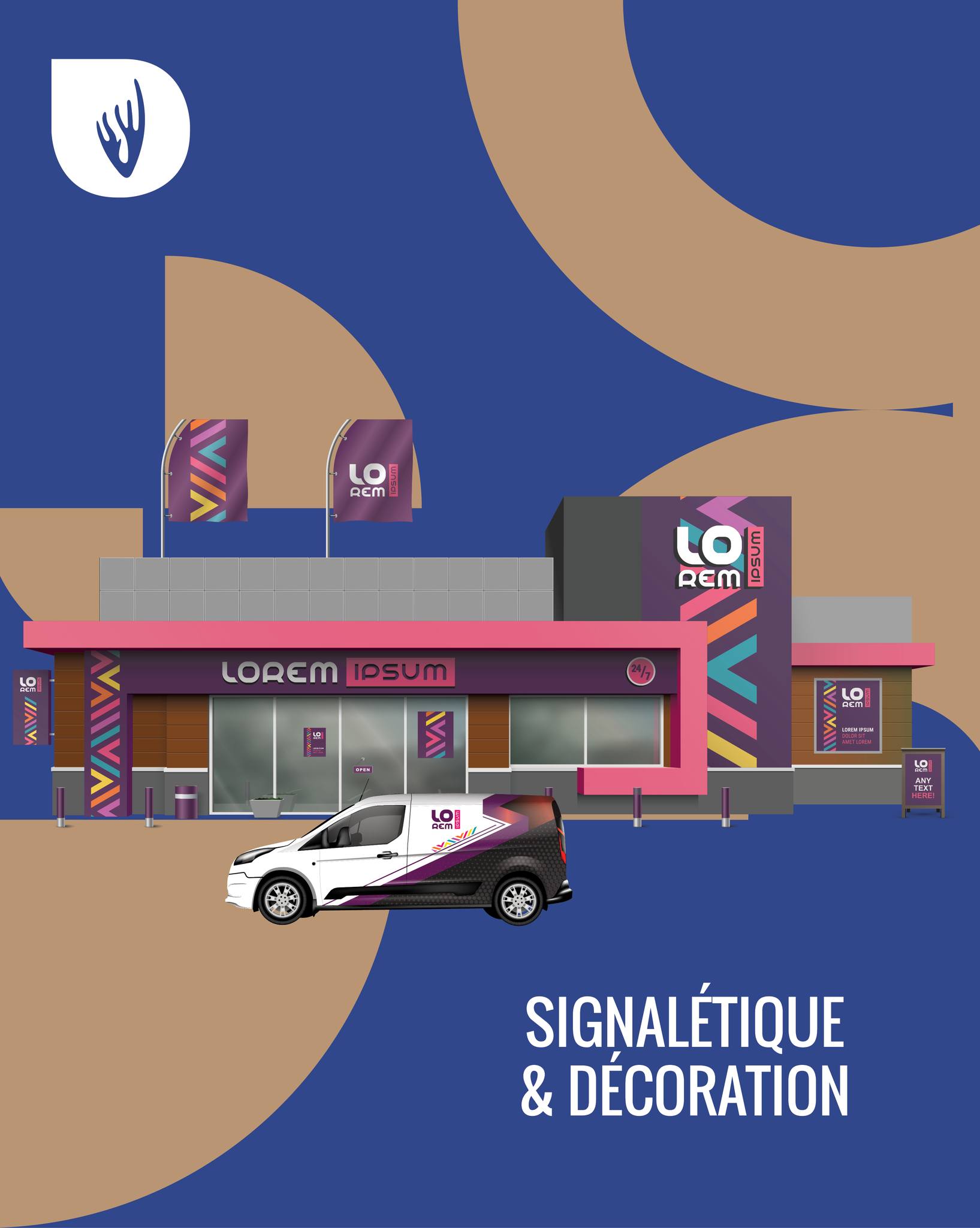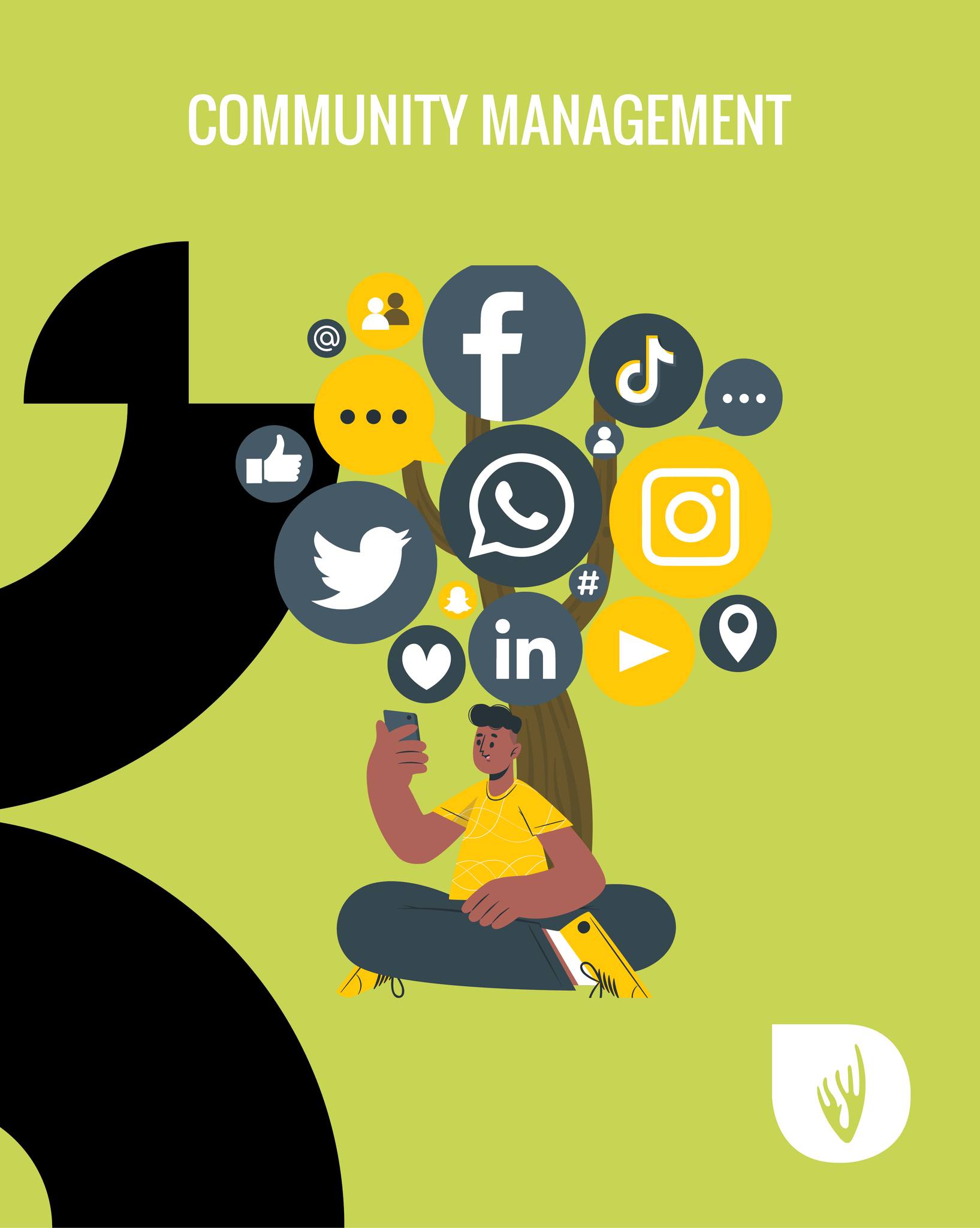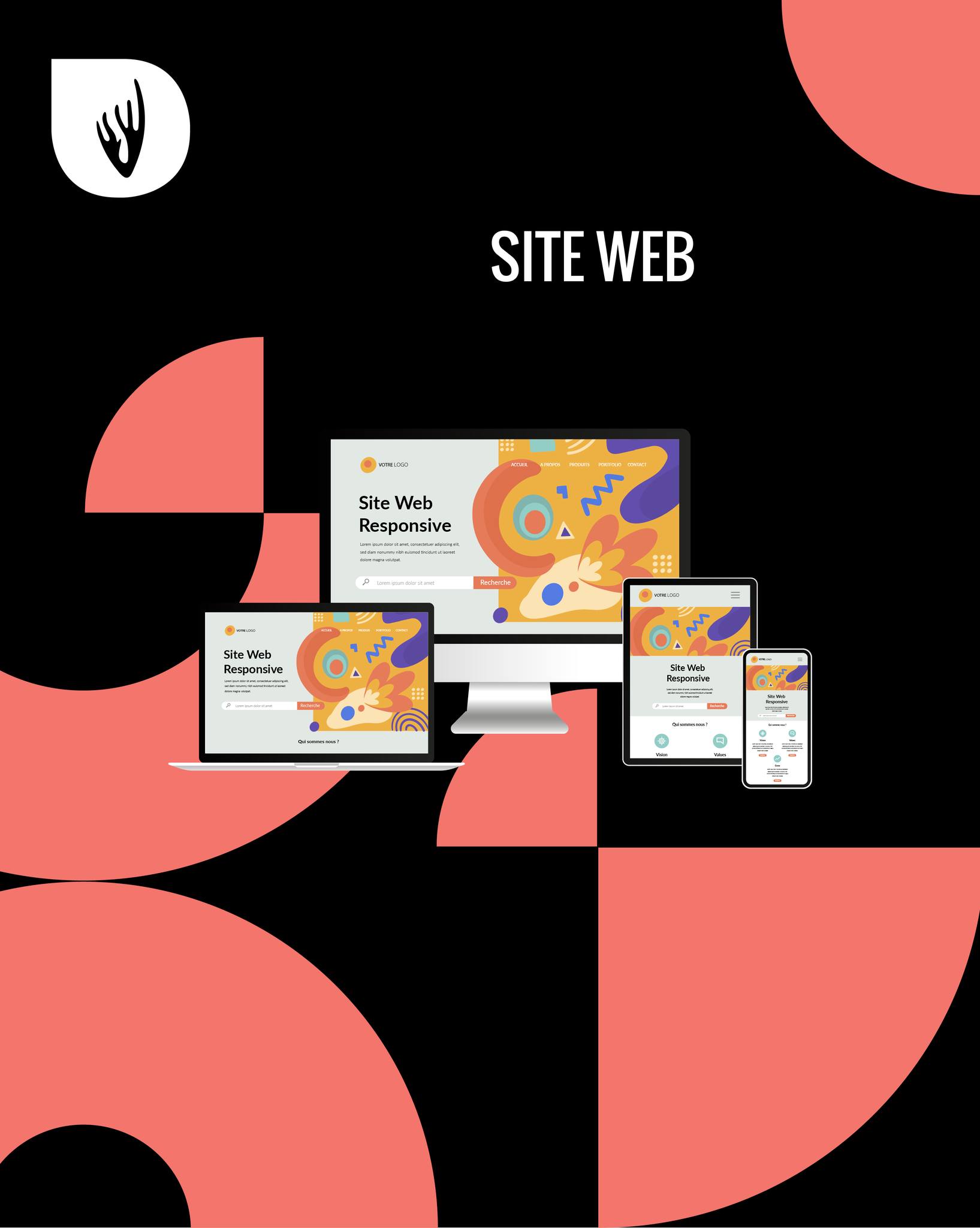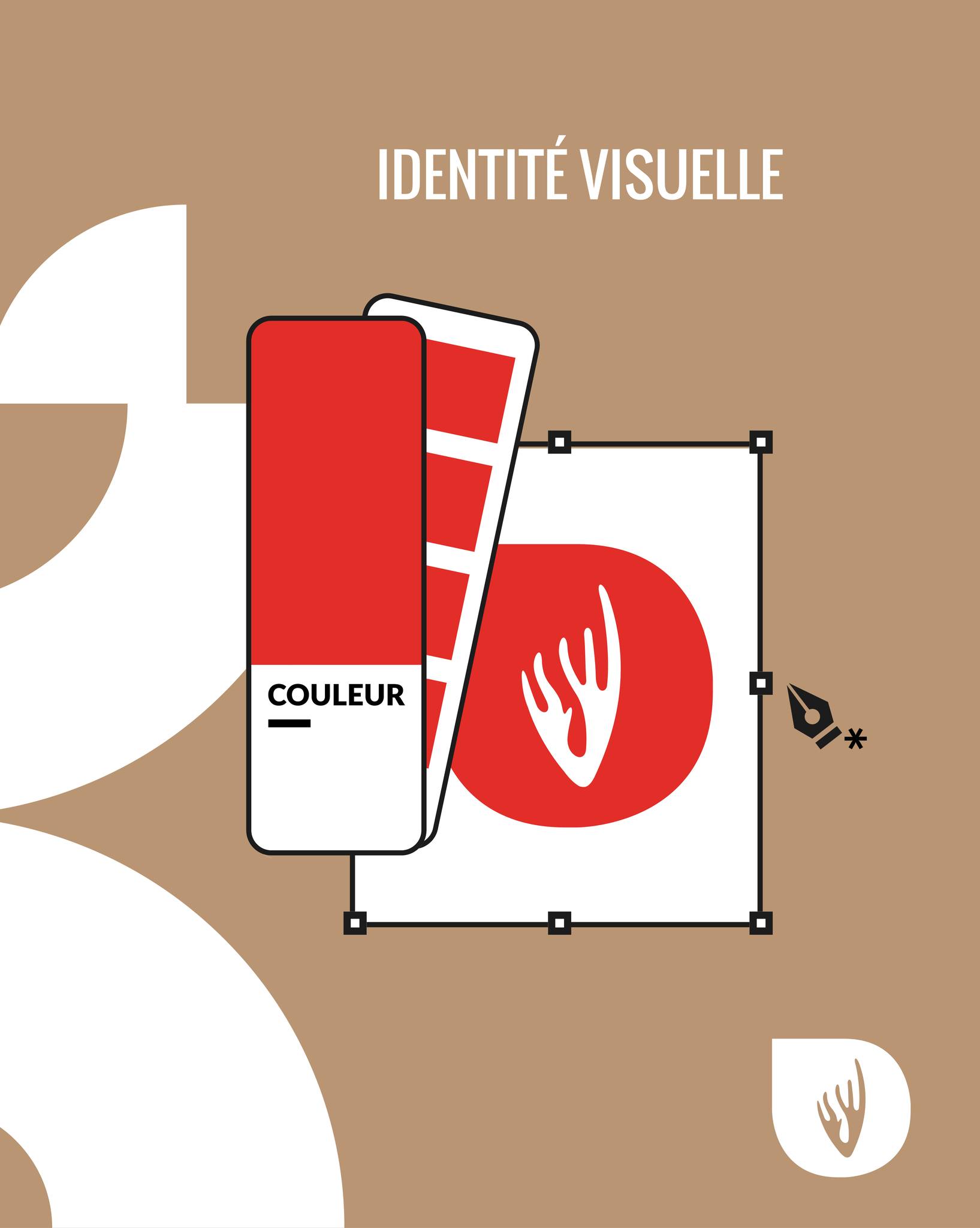Corsica isula muntagna
On a coutume de dire : « La Corse est une montagne dans la mer ». En y regardant de plus près, d’un point de vue géologique, il s’agit en réalité de deux massifs montagneux qui se juxtaposent.(1)
A Corsica ercinica
Sur le versant occidental, la chaîne la plus ancienne est datée entre 340 et 240 millions d’années (Ma). Elle est constituée principalement de granites et de rhyolites, occupant les deux tiers de l’île. Cette chaîne, dite hercynienne, comprend les cinq massifs les plus élevés :
Le Cintu (2 706 mètres)
Le Rotondu (2 622 mètres)
Le Monte d’Oru (2 389 mètres) Le Monte Renosu ( 2352 Mètres) L’Incudine (2 136 mètres)
En principe, les montagnes les plus anciennes sont les plus érodées, donc aussi les plus basses. Pourtant, en Corse, un paradoxe s’observe : les formations les plus anciennes sont les plus hautes, tandis que celles de la Corse alpine, plus récentes, sont plus basses. Ce phénomène s’explique par la collision entre deux plaques tectoniques, qui a « rajeuni » et surélevé le socle hercynien d’un bon millier de mètres.
Ce processus est à l’origine de paysages spectaculaires, où des sommets fortement érodés atteignent des altitudes anormalement élevées. De plus, la présence de glaciers, qui ont fondu il y a un peu plus de 10 000 ans, a façonné ces vallées, laissant derrière eux des lacs glaciaires, des tourbières et des « pozzine », véritables joyaux de la montagne corse.
A Corsica alpina
Sur le versant oriental, comme dans les Alpes, la disparition de l’ancien océan liguro-piémontais (170 à 60 Ma) a laissé des schistes métamorphiques et des ophiolites de l’ancienne croûte océanique (roches vertes). Le San Petrone, dans la Castagniccia, culmine à 1 767 mètres et constitue le sommet de la Corse alpine. On trouve également le Monte Stellu, qui domine le Cap Corse, et la Cima e Follice (1 322 mètres). Le massif de Tenda, avec le Monte Astu (1 535 mètres), complète cet ensemble. Cette diversité géologique offre des paysages colorés variés, allant du vert d’Orezza aux cipolins de Brandu, en passant par les marbres de la Restonica.
Una geulugia cuntrastata
La Corse n’a pas toujours été une île. Les preuves scientifiques attestent désormais d’une dérive du microcontinent corso-sarde, qui a eu lieu entre 29 et 15 millions d’années avant notre ère (Ma). (2)
Ce phénomène s’est inscrit dans un vaste mouvement d’ensemble ayant entraîné la disparition de l’ancien océan de la Téthys. La création des Alpes s’est accompagnée d’un étirement des marges du continent européen, provoquant une faille qui a conduit à l’insularisation du bloc corso-sarde.
Ce mouvement a fini par se stabiliser dans sa position actuelle il y a environ 15 millions d’années, marquant un événement majeur dans la formation de la Méditerranée occidentale. Le fait que la Corse et la Sardaigne soient situées sur une plaque tectonique isolée explique la quasi-absence de tremblements de terre. Cette zone peut ainsi être considérée comme asismique. La séparation de ces îles du continent expliquerait également l’endémisme exceptionnel de la flore.
Una flora indemica
Plusieurs hypothèses ont été émises sur l’origine de cette flore. Selon Braun-Blanquet, il s’agirait d’une flore paléogène développée in situ, c’est-à-dire une flore du Tertiaire moyen ayant évolué localement, avec des apports externes limités. Ainsi, la Corse compte 2 978 taxons végétaux, dont 296 espèces endémiques.
Parmi elles, 131 espèces sont propres à la Corse et 75 sont partagées avec la Sardaigne (endémiques corso-sardes) La végétation corse s’organise en plusieurs étages en fonction de l’altitude et de l’exposition :
Les étages de végétation (3)
1. Thermoméditerranéen (0-100 m) :
Présent uniquement à l’adret (A Sullana), cet étage est caractérisé par la série du lentisque.
2. Mésoméditerranéen (100-1 000 m) :
Jusqu’à 600 m : série du chêne-liège.
Jusqu’à 1 000 m : chêne vert et arbousier. Cet étage abrite de nombreux villages de l’intérieur.
3. Supraméditerranéen (1 000-1 300 m) :
Dominé par la série du chêne et du pin laricio.
4. Montagnard (1 300-1 800 m) :
Comprend la série du pin laricio et les bergeries traditionnelles (i stazzi).
5. Cryo-méditerranéen (1 800-2 200 m) :
À l’adret : série du genévrier nain et de la spinella.
À l’ubac (L’Umbria), subalpin : série du sapin et de l’aulne odorant (1 600-2 100 m).
6. Alpin (2 200-2 700 m) : Pelouses mésoxérophiles à l’adret.
L’animali
Il est inutile de chercher des ours, des loups, des chevreuils ou des vipères : ces animaux n’existent pas en Corse. En revanche, l’île abrite de nombreuses espèces endémiques, comme la Muvra (le mouflon corse), qui est également présent en Sardaigne.
Le mouflon, introduit par l’homme au Néolithique, était initialement une brebis domestique qui s’est redevenue sauvage.
La faune corse inclut également des espèces observées dans d’autres massifs montagneux :
Le gypaète barbu (l’altore), présent notamment dans les aiguilles de Popolasca. Ce rapace, surnommé le «nettoyeur des alpages», jouait un rôle sanitaire en se nourrissant des carcasses d’animaux (chèvres, moutons). Aujourd’hui, en raison de la diminution du pastoralisme, son alimentation est partiellement prise en charge par les agents du Parc Naturel Régional de la Corse (PNRC).
Depuis les premiers peuplements humains, l’homme a investi l’étage montagnard, y construisant des bergeries (i stazzi) et s’adaptant parfaitement à ce milieu. Le climat méditerranéen, marqué par une période de sécheresse estivale, a rendu la transhumance nécessaire (a muntagnera).
Les bergers se déplacent avec leurs troupeaux entre la plaine en hiver (a piaghja) et la montagne en été (a muntagna)
A Corsica, un’isula muntagna, nata da una geulugia cuntrastata, induve si sò scuntrate duie placche tectoniche. A catena cristallina, detta ercinica, hè a più vechja è porta e cime e più maiò : Cintu, Rutondu, Monte d’oru, Renosu, Alcudina. Face fronte à a Corsica alpina, incù u San Petrone, Sant Anhjulu, Monte Stellu, Monte Astu. Issu scontru tectonicu à ringhjuvanitu e furmazione geulogiche e più anziane chì si sò trove rialzate d’un millaiu di metri, fendu cusì a bellezza eccezziunale di sti lochi altieri. L’altru fenomenu maiò fù a spicchera di u microcuntinente corso-sardu di u cuntinente europeu, d’epica terziaria, chì spiega l’endemisimu di e spezie animale è vegetale.
A muntagna hè sempre stata un locu di vita, e muntagnere di i pastori ci anu lasciatu numarosi stazzi, testimugnanzie d’un tempu induve u pasturalisimu era diffusu in l’isula sana. I lignaghjoli è i carbunari dinù ci anu straziatu, per sfruttà e risorze di legnu.
Oghje si pone u prublema di a disertificazione di u centru di l’isula, i paesi chì si sviotanu, paesani oramai diventati citadini, per ingunfià e cità litturale chì si sò sviluppate.
Fà campà l’internu diventa oghje un attu militante, fà rinnasce un’ecunumia di muntagna serà a sfida di ‘ssu vintunesimu seculu. Parechje persone sò impegnate in st’opera cullettiva di salvaguardia di st’ecunumia identitaria per pruvà di trasmette i valori di a sucietà corsa di ‘ssi tempi passati.
Sì nò riescimu à cunghjucà turisimu durabile è attività umane, ragiunevule, chì stianu à scala umana, primurose di salvà u so circondu, tandu si puderà sperà un avvene serenu per i nostri figlioli.
Testu : Marcel Montisci