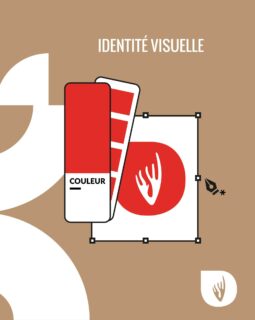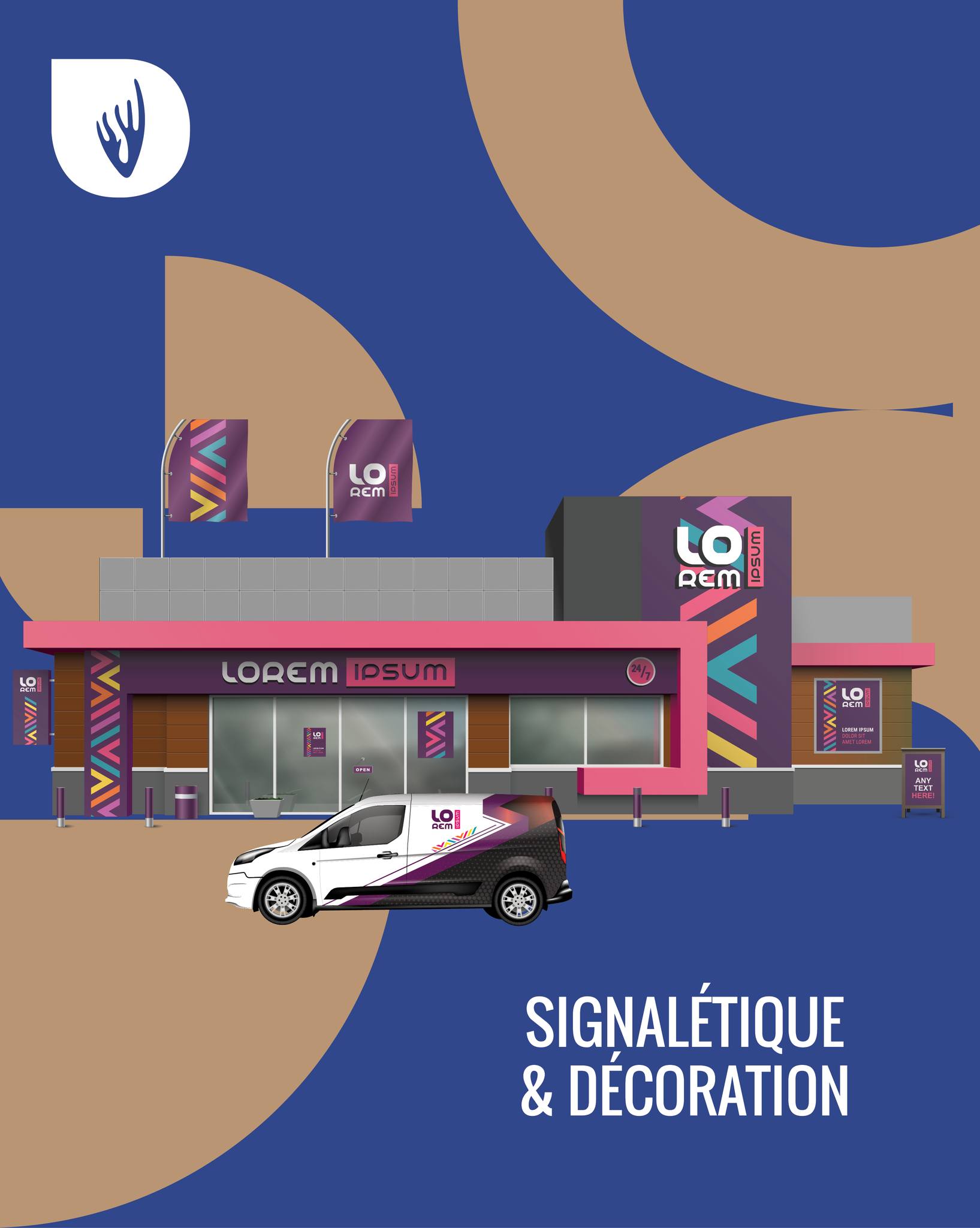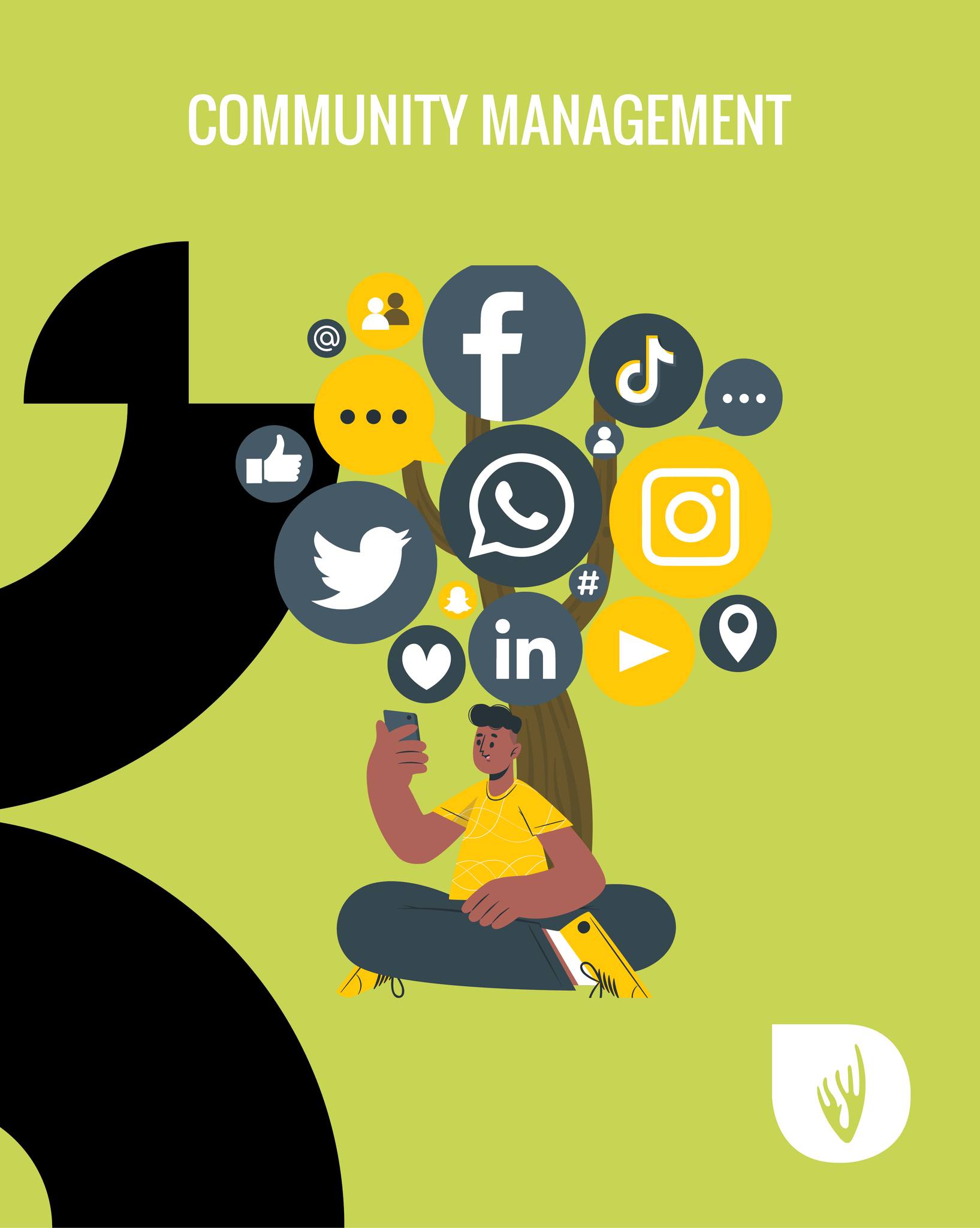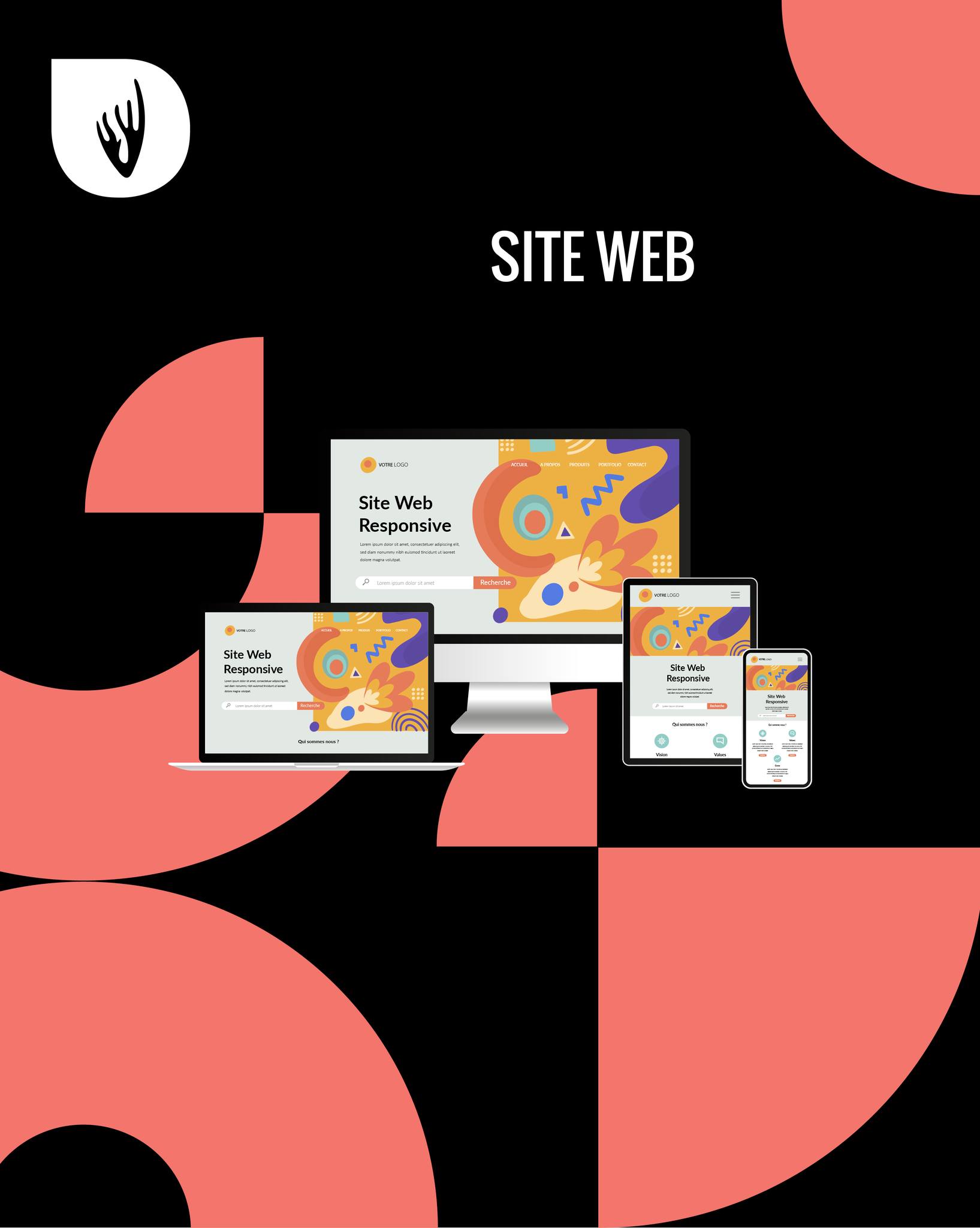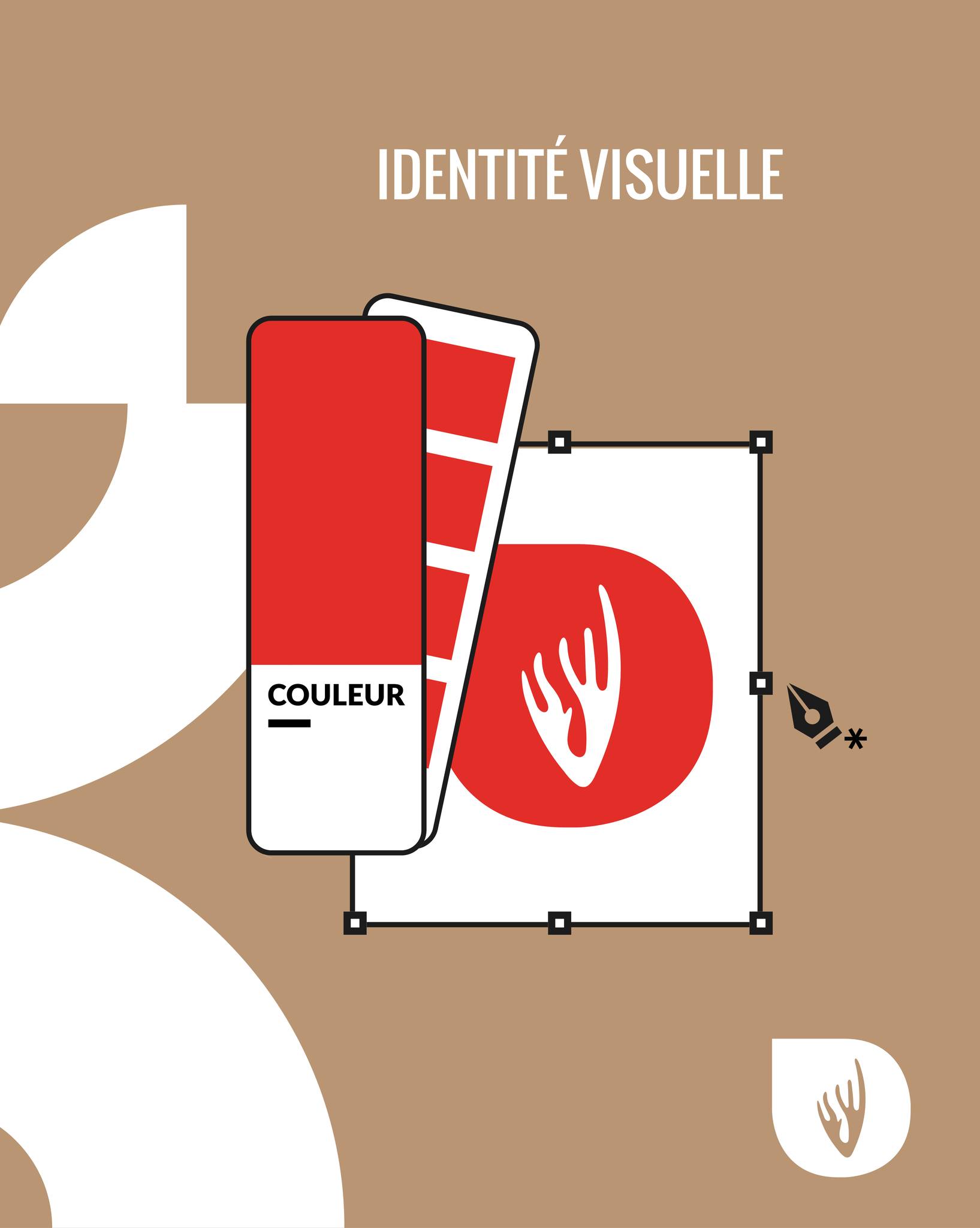On raconte souvent qu’il n’y a pas si longtemps, les femmes recevaient en héritage les propriétés situées sur le littoral : des terres alors infestées par la malaria et le paludisme, impropres à l’élevage.
À la suite de l’éradication de ces fléaux par les armées alliées stationnées sur la plaine orientale lors de la Seconde Guerre mondiale, ces parcelles autrefois sans valeur virent leur prix s’envoler. L’essor du tourisme, du développement agricole et de l’urbanisation littorale entrainèrent un véritable retournement de situation. Ces femmes, quasi déshéritées à l’époque, virent leurs biens prendre une valeur considérable, tandis que les hommes, qui s’étaient vus confier des terres agricoles près des villages de l’intérieur, subirent une forte perte de valeur foncière. Les villages, touchés par l’exode rural, sont encore aujourd’hui en proie à la désertification. Cette histoire, souvent racontée sur le ton de l’anecdote aux touristes, laisse entrevoir une société patriarcale, profondément injuste envers les femmes. Mais qu’en est-il réellement ?
La transposition du mode de vie paysan des siècles passés à nos sociétés de consommation actuelles permet de nuancer quelque peu l’analyse des faits. À travers cet article, je vous propose une réflexion, à la lumière d’une étude qui permet de mieux comprendre la société d’alors. En matière de succession, il faut distinguer le droit successoral écrit de la tradition orale. En pratique, le principe ultime de la transmission du patrimoine foncier est… l’absence de transmission. L’idée est celle de l’indivisibilité des biens : le patrimoine n’aurait pas à se transmettre !
Le terme utilisé, casale, comprend le patrimoine dans sa totalité : le verger de châtaigniers, le troupeau, les jardins. Il renvoie directement à la maison, a casa, étroitement liée à la lignée, au nom de famille, a casata. Il constitue un ensemble, une « manufacture » au sens ancien du terme, qui regroupe une force de travail disposant de moyens productifs indivis : un groupe puissamment équipé pour assurer sa subsistance. Le chef de famille, u patrone, est le véritable gestionnaire. Il est davantage responsable du patrimoine foncier, qu’il ne peut s’en servir pour son propre compte. Il administre l’ensemble des biens qui servent de support à la survie et à la reproduction de son groupe familial. Il veille à éviter le fractionnement de la propriété et oriente, à ce titre, les stratégies matrimoniales. Pour éviter ce morcellement, tous les garçons n’étaient pas destinés au mariage : certains devenaient oncles, i zii, et finissaient leur vie en tant que vieux garçons, figlii, au service de la famille. En 1931, le taux de célibat des hommes âgés de 18 à 59 ans était de 45,1% en Corse, contre 29,8% dans la moyenne nationale.
Les filles devaient en revanche se marier tôt : l’immense majorité d’entre elles quittait le domicile familial avant 25 ans. Quand elles recevaient une dot (u succhju) ; en cheptel animalier ; celle-ci était évaluée en valeur monétaire afin d’aider leur époux à constituer un nouveau patrimoine (u ceppu). Mais elles étaient dès lors exclues de la succession. Dans tous les cas, la terre allait plus facilement à un gendre parent qu’à un beau-fils originaire d’un autre village. Cela explique le fait que le beau-fils continental (pinzutu) qui avait déjà une situation professionnelle autre que paysanne, recevait plutôt des terrains situés en plaine, sans vocation agricole.
Ceci, afin de ne pas complètement désorganiser l’ensemble du système de production de la famille. Il est anachronique de comparer notre société de surconsommation avec celle du siècle passé, qui dépendait directement de la capacité d’un groupe à s’autosuffire sur les plans économique et alimentaire. En d’autres termes, il s’agissait davantage d’une société de subsistance qui cherchait à conserver les terres agricoles près de leur lieu de vie immédiat ; dans une logique pragmatique de survie collective ; que d’une société qui déshéritait délibérément les femmes par pure misogynie.
À terme, l’abandon progressif des terres situées à proximité des villages a mené aux zones de déprise agricole que nous connaissons aujourd’hui. Les anciennes terrasses de culture envahies par les chenaies, les murs en pierre sèche bâtis par des générations d’ancêtres, en sont les derniers témoins visibles. Ils nous laissent entrevoir ce que furent ces temps révolus – jusqu’à une époque encore très proche de la nôtre.
In Corsica, fin’à l’anni sessanta, a trasmissione di a terra ùn si basava tantu nant’à u dirittu scrittu, ma nant’à tradizione urale è logiche di sopravita. U casale, chì includia i castagni, u bestiame, l’orti, è a casa era cunsideratu indivisibile, era liatu à a casata chì firmava, furmendune u ceppu. U patrone appartenia ellu stessu à stu patrimoniu, ch’ellu gestia per u bè di tutti i soi. E donne partianu spessu in matrimoniu cù una dota (u succhju), ed eranu in cunsequenza escluse d’a successione. D’altrò, i masci ùn eranu tutti maritevuli : certi diventavanu zii è stavanu figlii à serviziu di u casale. L’idea chì e donne fussinu spugliate hè appena simplista, a realità era più cumplessa è sempre messa à prò di l’autosufficienza agricula di a famiglia sana.
Testu : Marcel Montisci